








L'Art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer
Henri Bergson
Glasba

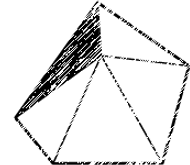

AMERICAN HONEY
Andrea Arnold
En découvrant il y a 10 ans le cinéma d'Andrea Arnold, je mettais le pied dans une radicalité qui n'était plus que formelle mais qui touchait cette fois-ci aux personnages eux-mêmes. Impassibles, jusqu'au boutistes, imperméables aux concessions, les caractères dessinés par la cinéaste britannique laissent des marques dans la mémoire des cinéphiles. Ils vivent, se battent, réagissent au sens le plus stricte, en résistance à ce que la vie peut leur infliger de plus violent.
En débutant American Honey à la manière d'un film social, Andrea Arnold transporte la veine du cinéma britannique la plus réaliste au pays des apparences. Elle en profite pour faire éclater en quelques minutes les belles histoires d'une Amérique opulente, blanche et heureuse. Et ce n'est évidemment pas un hasard si la peau qui fouille les poubelles d'un hypermarché en ouverture du film est celle d'une jeune métisse flanquée de deux enfants blonds.
Un horizon bouché, une condamnation à la pauvreté, l'alcoolisme et la violence pour la vie, c'est la seule promesse de cette Amérique à ces trois là.
Y-a-t-il un terreau plus fertile à la fabrication des victimes éternelles du libéralisme triomphant ?
Lorsque surgit un groupe d'adolescents et de jeunes adultes apparemment détachés des conventions sociales, libres de leurs mouvements et de leurs actes, Star, du haut de ses 17 ans voit en eux l'occasion de fuir un père incestueux et une communauté vouée à la misère. Elle embarque donc dans le van pour sillonner les Etats voisins et vendre des magazines de portes en portes, rencontrant ainsi toutes les variations d'un pays ancré dans la religion, dans les conventions et l'hypocrisie induite.
Mais peu importe l'intrigue, Andrea Arnold ne compte pas nous refaire sa filmographie vue d'Outre-Atlantique.
Elle profite de la volonté de Star de voir le Monde pour nous ouvrir un peu plus au sien, mélange de réalisme cru et de poésie chargée d'espoir.
Sauf que chez elle, rien n'est jamais simple. Elle laisse Star évoluer dans des espaces infinies au rythme de tout ce que comporte la jeunesse : musique, fêtes, rires, cris, larmes, explosions de sentiments toujours forts et contradictoires. Mais cette évolution se fait dans un cadre serré à son maximum puisque la cinéaste use d'un format d'image carré qui, loin de condamner ses personnages à l'étroitesse de l'espace, les placent dans un cadre qui pousse à l'exultation, à l'emprunte essentielle des lieux et du temps. N'oublions pas qu'Andrea Arnold est une cinéaste de paradoxe. Ce cadre stricte et étroit bloque le regard sur des détails mais aussi et surtout sur des personnages qui se retrouvent comme enfermés dans un aquarium, cherchant l'air de toutes leurs forces, en quête de vie, bien loin de la recherche logique d'une issue de secours.
Cependant, ce cadre fermé auquel le Cinéma semble avoir définitivement tourné le dos, à l 'exception du grotesque Momy où Xavier Dolan ne l'utilisait que dans une logique vaguement esthétique, cet espace réduit et carré pose la question de l'imaginaire et du hors-champ.
Quid du futur possible pour cette bande engluée dans une jeunesse éternelle
La répétition de certaines scènes semble souligner cette question. La liberté et l'imagination ne sont plus en action dans les actes de Star et de ses compagnons.Rêves inexistants, espoirs éphémères, amours brisés, même les horizons géographiques sont fermés. L'opposition avec le mouvement continuel est frappante.
American Honey oscille donc entre deux forces en permanente opposition : l'acharnement et la vivacité de la vie que rien ne semble pouvoir arrêter contre la mort des idéaux à peine nés et le déterminisme social.
Andrea Arnold fait preuve comme toujours d'une formidable empathie pour ses personnages. Elle les comprend, les ausculte et porte une foi peu commune dans leur capacité à devenir. Elle les place dans une cosmogonie qui rappelle parfois celle de Terence Malick et c'est la grande preuve d'espoir qu'offre ce film bouleversant qui use de sa longueur pour nous encercler, nous pousser à prendre part aux angoisses, aux peines et aux joies de Star. Elle nous met en position frontale avec elle, fait suffisamment rare pour que nous ne trouvions pas dans American Honey toute la vie contenue dans cette jeune femme, toute la force de l'espérance d'une existence en devenir.
S.D
JACKIE
Pablo Larraín

Du XX ème siècle, nous retiendrons l'image. Fille du siècle, elle en devient la garante mémorielle parce qu'elle est jeune et caractérise une certaine idée de l'objectivité. Pourtant, on sait que comme les mots, elle porte en elle un langage et qu'elle peut donc mentir à partir de là. Elle peut faire mine de montrer alors même qu'elle cache. Elle ne porte pas plus que le reste la vérité en elle, elle en porte une marque chaque fois subjective, car l'image à cela de fort et de faible à la fois : elle est le prolongement d'un regard porté par un œil et celui-ci n'a d'objectivité que celle que lui accorde l'humain qui se cache en lui.
Le siècle passé n'a eu de cesse de créer de l'image abondamment. Elle a servi à distraire, à informer ou à se souvenir. Parfois, la frontière fut mince entre ces trois territoires et quelques faits ont mélangé les champs d'expérience au point de ne plus les rendre lisibles. De guerres, de crises ou d’événements, les représentations sont nombreuses qui questionnent la place de l'image dans nos imaginaires, mais le clan Kennedy et la tragédie du 22 novembre 1963 à Dallas en a été un formidable catalyseur qui marqua les consciences jusqu'à y créer des mythes, des fantasmes, et dans l'imaginaire populaire une empathie forcée par la puissance de ses représentations.
Aujourd'hui, Pablo Larraín décide de traiter de ces 3 jours qui bouleversèrent le Monde. Il sait combien notre mémoire est mitraillée d'images lorsque l'on évoque cette date. Le tailleur rose qui glisse à l'arrière de la limousine présidentielle, le crâne de JFK qui vole en éclat, le garde du corps qui se jette dans le véhicule... le cinéma s'est chargé de reconstituer les parties manquantes. Nous n'ignorons rien de l'autopsie, de la prise de fonctions de Lyndon Johnson dans l'avion qui retourne à Washington ; et nous ne savons d'ailleurs plus très bien si nous avons en tête les images de l'effondrement de Lee Harvey Oswald à la sortie du commissariat ou si ce ne sont que les reliquats de ses reconstitutions.
Pablo Larraín ne tranche pas. Reconstitution ou images d'archives, peu importe, il sait que l'image est à la fois vérité et mensonge. Il ne cherche pas à en délimiter les contours mais au contraire à user de cette dualité pour atteindre une autre vérité, plus invisible à nos yeux.
Que savons-nous de cet événements et des deux jours qui ont suivi ? Rien en somme. De petites anecdotes, quelques images filmées, des photos de presse... mais de la vérité la plus intime, celle de l'humain et du cœur, de l'usage de l'empathie, qu'avons-nous fait ?
C'est là tout le propos du cinéaste : parvenir à rendre compte de l'empathie au-delà de toute vérité. Et, il place au cœur de son mécanisme l'autre icône de ce drame : Jacquie. De cette réalité d'hommes, de ce jeu politique et médiatique exclusivement masculin il extrait une île. Cette femme, presque une silhouette servant de représentions glamour à la l'épouse modèle, mère de famille parfaite, silencieuse sauf quand il s'agit de parler de décoration d'intérieur et de mettre en valeur l'homme providentiel, auguste chef de famille et donc d'une nation tout entière. Et de cette femme, il fait l'enjeu d'un film qui brasse l'intime et le spectacle.
Natalie Portman n'incarne pas le personnage publique, elle fait d'elle l’allégorie de la passion. On perçoit sa souffrance, ses colères intérieures, ses doutes et les éclairs de lumière qui la transperce. Car cette Jacquie que Larraín nous présente ici porte en elle la dimension mystique qui traverse la filmographie du chilien. Son besoin de transcender l'humain, d'en retrouver la source, sa part essentielle, cette recherche du dénominateur commun devient tout l'enjeu de ce film qui n'oublie jamais de s'adresser au public. Il ne se parle pas à lui même, il fait le pont entre les existences et c'est là toute la puissance du cinéma empathique. Une rareté.
S.D
Vu au cinéma
Vu au cinéma
THE LOST CITY OF Z
James Gray

Vu au cinéma
En commençant par Little Odessa avant de continuer avec The Yards, James Gray dressait une géographie des territoires dans lesquels évoluaient ses personnages. Avec Two Lovers, l'espace urbain devient prégnant et répond à l'état mental du personnage joué par Joaquin Phoenix. Dans the Immigrant, la frontière est autant celle des continents que celle qui forme les limites de l'esprit américain vis à vis des nouveaux arrivants. Et puis, la ville, les lieux, les autoroutes et la banlieue qui se dresse tout autour dans We Own the Night.
Des espaces, des territoires qui délimitent l'action et s'imposent comme les uniques univers perceptibles par les êtres qui peuplent les films de James Gray. Serons-nous alors étonnés de découvrir que Fawcett, le nouveau personnage central placé sous l’œil du cinéaste est géographe ?
D'autant que Percival Fawcett exista réellement. Il fût géographe pour l'institut royal et rendit compte d'une cartographie des frontières séparant le Brésil de la Bolivie.
Bien évidemment, James Gray ne s'interresse pas au Biopic mais à la variation sur un même thème. En l’occurrence celui du clan, de la famille et des limites que l'homme s'impose à lui même.
On le sait, James Gray puise sa culture dans un cinéma très urbain, directement hérité de celui du nouvel Hollywood. William Friedkin, Arthur Penn, Michael Cimino et Martin Scorsese sont au centre de ses préoccupations cinéphiliques et autant dire que le défi d'un film comme The Lost City of Z est conséquent pour qui trace une ligne aussi claire que Gray dans le paysage cinématographique des ces deux dernières décennies.
En ouvrant le film sur une chasse virtuose, il fait éclater le bruit et la fureur d'une Angleterre de classes, corsetée dans les dogmes et les appareils. D'emblée, on perçoit que la force de Fawcett tient dans une femme. Discrète aux yeux du monde, elle incarne le futur des femmes européennes par la liberté de ses choix (dans la limite de ce que lui permet l'époque et la société dans laquelle elle évolue) et par la force qu'elle porte tout autant que son mari dans l'avancée de leurs travaux. Gray suppose une chose : il n'y a pas un Fawcett mais sous ce patronyme se cache un être à deux têtes. Le couple est indivisible et est le garant des forces de l'un et de l'autre. Ils sont les deux côtés d'une frontière, différents mais inséparables. L'un comme l'autre deviendra notre référent géographique dans les va-et-vient d'un continent à l'autre.
De ces espaces éloignés, il n'existe rien de commun. L'inconnu pour l'un qui devient lui même étranger à l'autre. Dès lors, on ne se fait jamais une idée précise de ce que l'on ne perçoit pas. Et tout le sens de l'abstraction développé jusqu'ici par James Gray prend dans ce film un sens décuplé.
En effet, on se souvient de la scène finale de Little Odessa au milieu de draps immaculés, de la scène dans les roseaux enfumés et celle de la poursuite en voiture sous la pluie dans We Own the Night, on se souvient de ces trains arrêtés qui cachent les êtres dans The Yards, de la fumée qui embrume les rues dans The Immigrant. Chez James Gray, voir n'est pas savoir. On devine certaines actions, on perçoit le monde et l'environnement mais on n'en capte pas les détails. Avec ce film, il joue de cette abstraction. Les feuillages cachent la jungle, sa réalité, sa profondeur, sa matérialité. Le lieu devient mental, perceptible mais pas visible. Tout y est obscur et abstrait. Le doute devient image, l'image doute d'elle-même. L'héritage d'un cinéma en quête de repères refait surface.
En effet, pour Gray, il faut référencer le Cinéma. Il faut, à l'image de ses films, donner une filiation aux filmographies qui se succèdent. Pour cela, Gray s'est choisi des pères, et si pour The Lost City of Z, Francis Ford Coppola (mais plus exactement Conrad) ou Friedkin semblent prévaloirs, il faut encore douter. Les références explicites à Werner Herzog avec cette scène tout droit sortie de Fitzcarraldo dans laquelle les explorateurs croisent le chemin d'une troupe d'Opéra au milieu de la jungle, les scènes de folie qui s'empare des hommes, ces indiens dont on ne sait pas très bien s'ils sont menaçants ou bienveillants... tout cela renvoi à cette filiation, cette hérédité qui construit l'ADN du cinéma de James Gray.
Avec ce dernier film, il poursuit son tracé qui tente de cartographier son travail et ses obsessions. The Lost City of Z est un film somme, une épopée tragique qui catapulte le cinéaste dans ses mondes mentaux. L'aventure bien sûr y est omniprésente. La trame renvoie à l'aspect le plus populaire des grands films américains. Et c'est là que se situe l'une des forces du cinéma de Gray. Il sait parler à tous parce qu'il sait d'où il vient. Sa réflexion interne ne parasite pas sa relation au spectateur mais les deux se complètent. Ses films sont des dialogues entre le Cinéma et le Monde, entre le spectateur et le cinéaste, entre les spectateurs eux-mêmes. Par les personnages transitent toutes les langues, toutes les préoccupations du monde. Et ce n'est pas rien que d'arriver à parler tous ces disours à la fois et les faire s'enchevêtrer dans le brouhaha du Monde.
S.D
Album de Famille
MEHMET CAN MERTOĞLU
Il y a ces mises en scène, ce faux ventre, l'administration et le mensonge omniprésent.
D'ici, le cinéma Turc est une affaire compliquée. Entre comédies populistes et cinéma d'auteur contemplatif, l'image que nous en avons est toujours bien éloignée de la réalité et de sa vigueur.
Avec Album de Famille, nous entrons dans un cinéma qui oscille entre la comédie et le drame, et le registre dans lequel il évolue est bien loin des considérations esthétiques et morales de Nuran Bilge Ceylan ou de Deniz Gamze Ergüven.
La charge est clinique, elle prend l'absurde pour arme, une pointe de cynisme en bandoulière. C'est au cinéma de Roy Anderson que l'on songe de prime abord car cette collection de plans fixes, larges , aux cadres strictes compensés par des profondeurs de champ qui en disent long, cette grammaire à l'usage incisif, rend le propos amer.
On sourit de l'enchevêtrement de situations qui cherchent à masquer la vérité. La société pèse de toute son absence et pourtant le couple ne guide ses actes que par le fantasme d'un jugement supposé du reste du monde. L'action n'est mue que par le qu'en dira-t-on. On sourit donc, du racisme ordinaire du couple face à un enfant « trop syrien » ou « trop kurde », et on s'angoisse en même temps de cette normalité d'un jugement qui semble porter tout le poids d'une Turquie contemporaine sous l'influence d'Erdogàn.
Bien sûr, le ton du film, coloré d'une ironie mordante, use de la longueur de ses plans pour appuyer sa charge et transformer le rire en une angoisse presque kafkaïenne. L'arme est alors à double tranchant et prend le risque de ralentir son rythme au détriment de son efficacité.
Reste que cet Album de Famille est, malgré ses défauts inhérents à de nombreux premiers films, la preuve qu'un cinéma courageux et grinçant peut s'épanouir dans une société nécrosée par la censure.
S.D

Vu au cinéma
VOYAGE OF TIME
Terrence Malick

Il y a quelques années, Tree of Life, malgré sa Palme d'Or avait dérouté le public. A tel point que certains défenseurs de Terrence Malick, accablés par cet hymne à la vie et et l'existence prirent certaines distances avec le cinéaste des Moissons du Ciel. Pour Glasba, la question ne s'est pas posée. Ardant défenseur des films les plus récents comme Knight of Cups, je n'éprouve pas le besoin de revenir sur ce qui fait selon moi la grandeur de la trilogie du cinéaste.
Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes face à un OVNI dans une filmographie déjà bien en mouvement. Le 4 mai 2017, il ne faudra pas rater l'unique séance proposée dans les salles françaises d'un poème cosmogonique chuchoté par Cate Blanchet.
Commandé par National Géographic, Voyage of Time est un périple au cœur de la naissance de la vie et projette de percevoir dans la Nature et le Cosmos la trace d'une force supérieure.
On a souvent reproché la dimension mystique dans le propos du cinéaste mais sans doute avions nous mal interprétés son discours. Il semble ici que Malick rende bien grâce à une puissance supérieure mais il n'y a rien de biblique ni d'aucune religion dans sa démonstration. La cosmogonie de Malick se suffit à elle-même et sert un propos humaniste qui relie toutes traces de vie entre elles. C'est la démonstration de l'idée du Tree of Life (l'Arbre de Vie) qui obsède le cinéaste, cette idée que chaque espèce, chaque création de la nature fait partie d'un tout, d'une dépendance à l'entièreté de l'Univers.
On comprendra moins les séquences alternatives plaçants des hommes et des femmes dans une existence concrète et contemporaine, baignée de misère et de destruction. Ces séquences semblent être en dehors du propos et plombent d'une certaine naïveté l'ensemble de Voyage of Time.
Reste que Malick maîtrise sa démonstration mystique et nous offre une succession de séquences admirables qui bouleversent notre apréhension de l'ésthétique universelle.
S.D
Vu au cinéma
Le recherche du bien et sa prépondérance culturelle dans nos sociétés est une fabrication des religions. Nous leur devons bien cela, elle ont créé cet équilibre qui tente de nous maintenir hors du chaos.
Malgré tout, si la question se pose dans les grands textes des grandes religions, c'est peut être que le bien n'est pas une chose innée chez elles, chez l'homme et dans ses constructions culturelles.
Quand nous découvrons l'horreur d'un crime sordide à Madrid, la veille de l'arrivée du Pape, en pleine effervescence du mouvement Podemos et sous une chaleur de plomb, l'équilibre tangue sérieusement. Deux policiers aux méthodes originales et opposées plongent dans le cloaque qui absorbera tout d'eux et révélera ce qu'ils pensaient avoir enfouis.
L'Espagne contient toujours le mal en elle. Le Franquisme n'a pas été éradiqué, il a été remplacé dans la douceur et sans rancoeur. Mais que sont devenus les vaincus de 1939? Que fait - on des crimes des Franco et de l'Église? Les âmes peuvent - elles être belles lorsqu'elles contiennent le chaos en elles à l'instar d'un pays entier?
Que Dios nos Perdone est un fantastique thriller qui s'émancipe de l'ombre d'un David Fincher pour aller au delà de ce qu'était Seven. Il condense la puissance des angoisses des plus grands films de Serial Killers avec le trouble de l'Histoire récente. Podemos, la vieille Espagne, sa modernisation, l'Église... Ce film renoue avec la fibre italienne des années 70 qui engageait le politique dans le champ du film noir.
En véritable manifeste contre le manichéisme, il s'acharne à décloisonner les certitudes et les habitudes pour en montrer toujours le revers. Et rappeler une fois de plus que bien et mal ne s'opposent pas, ils sont les deux faces d'une même médaille.
Il faut suivre cette traque dans une Madrid irrespirable, sentir sa moiteur et son brouhaha. Il faut respirer l'air vicié des scènes de crimes, entrer dans le monde parallèle de l'horreur pour y voir ce que nous tentons désespérément d'enfouir. Que Dios nos Perdone vous fera vivre l'expérience d'un été glacial sous un soleil accablant.
S.D
Que Dios nos Perdone
Rodrigo Sorogoyen

Vu au cinéma
L'individu ou le groupe? Le détail ou le général?
Robin Campillo veut tout. Il embrasse le groupe sans oublier l'altérité qui lui donne l'énergie nécessaire pour avancer.
Il ne s'agit plus d'être aimable, il s'agit de vivre et de le crier fort.
Avec 120 battements par minutes, il colle à la rage et condamne les issues. La lutte est vive et intense sans jamais être morbide. Elle est désespérée sans jamais douter. Et s'il faut la dispute pour sans cesse renouveler l'action alors soit, qu'elle explose.
La caméra de Campillo, elle, est mutique. Elle guette un regard, surprend un baiser. Elle passe derrière les portes pour écouter les conversations. Face à l'urgence, elle prend le contre-pied et s'installe en observatrice amoureuse. Dans un geste admirable, elle s'efface sans quitter ces hommes et ces femmes des yeux. Elle ne se lasse pas de les regarder vivre.
S.D
120 Battements par Minute
Romain Campillo

Vu au cinéma

